– Greta Gerwig ; 2018 –
À Sacramento, Christine refuse d’être appelée par son prénom. Elle veut qu’on l’appelle Lady Bird. En dernière année dans un lycée catholique privé, son rêve est de s’échapper de sa suburb ennuyeuse et d’intégrer une université suffisamment prestigieuse pour sortir de la médiocrité qu’elle perçoit chez ses parents, et surtout pour ne pas ressembler à sa mère, avec qui elle s’entend très mal. Cette dernière année au lycée sera cependant riche en évènements et en premières fois. Mais surtout, son entrée à l’université est compromise par ses notes moyennes et par la mise au chômage de son père…
Ne vous y trompez pas, sous la (belle) photographie sucrée et les atours de nostalgie douce amère du récit se cache un film assez puritain, vicieux et méprisant, à tel point qu’on se retient de le qualifier de détestable. Pas étonnant qu’il soit sponsorisé par Le Figaro. D’un strict point de vue cinématographique, tout tient debout : les acteurs jouent bien (surtout Laurie Metcalf), la photographie est très belle, le scénario tient parfaitement la route. On regrette juste une réalisation et un montage purement fonctionnels, qui font le boulot mais n’ont pas d’autre ambition spécifique que de raconter une histoire. Le film se suit donc poliment tant il n’a rien de surprenant dans sa mise en scène ni dans les situations abordées par un scénario somme toute franchement convenu pour qui a l’habitude des teenage movies.
Que reste-t-il alors à Lady Bird pour se particulariser (à part, on le souligne une dernière fois, sa plastique argentique très réussie) ? Le regard de Greta Gerwig sur l’histoire qu’elle raconte et sur ses personnages, le sentiment que l’artiste nous transmet sur le monde finalement. C’est bien là que le bât blesse, pour ne pas dire qu’il te met un bon chassé et te pète trois côtes. En voulant réinsuffler de la profondeur/spiritualité dans la jeunesse qu’elle filme, Greta Gerwig installe un jeu d’opposition assez consternant, qui prouve que si elle notre réalisatrice n’est pas pétrie d’intentions morales pénibles dignes du schtroumpf à lunettes, elle a au moins 32 ans de retard. Ainsi, complètement à rebours de ce que The Breakfast Club ou plus récemment American Vandal (série brillantissime à la conclusion absolument glaçante) ont pu nous apprendre de plus beau, notre égérie mumblecore va continuellement renvoyer ses personnages à leurs étiquettes sociales, et confirmer les clichés qu’elles véhiculent. Timothée Chalamet : il lit des livres de philosophie politique, fume des clopes et joue de la basse, serait-ce pour cacher que c’est une coquille vide ? Bingo. Jenna est une gosse de riche très belle qui aime faire la fête et l’amour, elle doit donc être superficielle pas vrai ? You got it. Face à ces deux là, Lady Bird, elle, a beau être une peste un peu weirdo, elle est authentique parce qu’elle a des problèmes et veut devenir artiste. On aurait envie de répondre, dommage que ce soit avant tout une peste, mais cela n’a pas l’air de déranger.

Universal France
Comme votre tatie Marion, celle-là même qui croit comprendre le principe de vos études mais en fait ne pige même pas le mot « massteurh », Greta Gerwig se cache derrière son visage avenant pour faire comprendre avec douceur qu’elle n’aime pas beaucoup les gens cools, parce que nécessairement superficiels. Ainsi, elle juge les gens sur ce qu’ils sont et non pas sur leurs actions. Peu importe que Jenna soit sympa et pardonne Lady Bird (alors même que c’est Lady Bird qui lui a menti en premier lieu BORDEL), elle sera renvoyée à sa superficialité, ici conséquence logique de son statut de gosse de riche, et son intériorité sera par là même niée ou pire, moquée. De même, Timothée Chalamet sera filmé comme un beau gosse insupportable sans que l’on sache véritablement ce qui motive un tel mépris (enfin, jusqu’à une scène de relation sexuelle).
Ce qui est curieux, c’est qu’à l’inverse, notre héroïne a beau avoir un cheminement mental plus complexe, son comportement général justifie franchement très mal qu’elle se retrouve « héroïne » de l’histoire, justement. Il suffit de la voir engueuler ses deux parents comme du poisson pourri parce qu’ils ne peuvent pas se permettre de lui payer une université (vraiment des ingrats non?) pour se demander ce qu’on fait en compagnie d’un être humain aussi désagréable, le genre qui, au terme d’une autre engueulade avec un ami venu s’excuser, n’hésite pas à renvoyer son acte de contrition avec un « but you’re gay » qu’on qualifiera poliment de déroutant. Mais la réponse viendra plus tard, à la fin du film, dans ‘un passage à la maturité’ extrêmement gênant et moralisateur, mêlant répliques pachydermiques autour de l’importance des prénoms et révélations grotesques à la messe (tiens c’est marrant le vrai prénom de Lady Bird c’est Christine, tout un programme) sur fond de spot préventif contre les abus d’alcool.
Lady Bird a ainsi l’air de constamment faire la leçon, l’air de dire « c’est bien de s’amuser mais il faut être sérieux dans la vie » mais avec le sourire, ce qui le rend encore plus désagréable si ce n’est malhonnête. Un drôle de rapport au corps et à la sexualité est par exemple brocardé au détour d’une réplique opposant le respect au désir sexuel comme deux pôles contraires, ce qui fera lever plus d’un sourcil, lors d’une scène romantique sous les étoiles. Évidemment, Lady Bird fait ce qu’elle veut de son corps et a tout à fait le droit de trouver cette sacralisation belle et poétique, quoiqu’on en pense. Mais Jenna a alors également tout à fait le droit de disposer de son corps également, de vouloir faire l’amour avec son copain et d’y prendre du plaisir quoi qu’on en pense, sans être justement opposée stupidement au modèle pur de Lady Bird. Sans être jugée finalement, surtout sur quelque chose d’aussi personnel. Ce que Greta Gerwig, en bonne moralisatrice prêchi-prêcha à l’aise dans ses à priori, semble être incapable de faire. On lui conseille de revoir la scène de Breakfast Club où Claire se confie sur sa virginité, et qu’elle comprenne que ce n’est pas le fait d’être vierge qui fait souffrir la jeune fille, mais plutôt de passer pour une aristo coincée à cause de ça. C’est la pression sociale, le regard des autres qui crée son malaise. Alors Greta, fais nous plaisir, admet que les gens font ce qu’ils veulent de leur vie, arrête de les regarder comme ça et pose ta caméra. Quant à vous, retournez voir La Folle Journée de Ferris Bueller.
Lino Cassinat






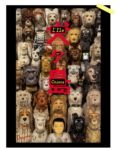
 © 2026
© 2026
Comments by Lino Cassinat