– Bertrand Mandico ; 2018 –
Précédé d’une réputation positive et sulfureuse, le premier long-métrage de Bertrand Mandico atterrit enfin dans les salles après une bonne année à faire la tournée des festivals. Le cinéaste actif depuis 1997 était en effet l’auteur de plus d’une vingtaine de courts-métrages tous plus étranges les uns que les autres, avant de venir nous livrer Les Garçons Sauvages, œuvre non moins étrange et radicale que les précédentes, mêlant esthétique expressionniste, récit décousu, lyrisme porno et (trans)sexualité. Qu’en est-il alors de l’OVNI de 2018 ? … C’est compliqué.
Les Garçons Sauvages est un film très frustrant, qui aurait pu être d’une force éclatante mais se révèle au final n’être qu’une magnifique et somptueuse coquille pleine de promesses malheureusement un peu vide. On ne demandait pourtant qu’à être convaincus par une œuvre qui, en ces temps bien puritains, ose mettre les pieds dans le plat et parler de et du sexe, des corps et des genres.
Le problème, c’est que si ces totems sont (très) présents à l’écran, ils sont curieusement à peine traités, ce qui donne assez rapidement l’impression que le stupre et la luxure ne sont convoqués que pour « faire » décadent et filmer des jets de sperme parce que l’effet choc est garanti plutôt que parce qu’il y a une nécessité de les filmer (ce qui rend d’ailleurs les deux scènes de viols franchement désagréables). Bref, c’est un peu gratuit, et même si ce numéro chic et choc de chien savant esthétisant est effectivement particulier et étonnant, il est aussi très vite lassant.
 Un fétiche incroyablement beau, mais vide de sens
Un fétiche incroyablement beau, mais vide de sens
À volontairement ne pas doter son film d’un telos, Mandico ne s’impose certes aucune barrière, ce qui lui permet de doter son œuvre d’un imaginaire foisonnant et riche mais dans le même geste il prive Les Garçons Sauvages de cap, de point de vue, de sens. Le tout est tellement brouillé que les dialogues eux-mêmes doivent verbaliser textuellement le fond de l’affaire au détour d’une réplique pour le moins discutable si ce n’est troublante d’Elisa Löwenhson, pour qui il faudrait « féminiser les hommes pour arrêter la violence », ce qui est un drôle (pour ne pas dire énorme) cliché de genre à entendre pour un film qui met autant d’efforts à vouloir les dépasser, au point d’avoir eu la brillante idée (ce n’est pas ironique) de faire incarner ses cinq garçons sauvages par des actrices.
On peut tout à fait rétorquer qu’une œuvre d’art n’a pas besoin à tout prix d’avoir de sens et peut même ne rimer à rien (dixit David Lynch), propos auquel on souscrit totalement. Cependant on aurait alors aimé que le film nous aide à débrancher notre cerveau et s’affranchisse d’un récit artificiellement gonflé par son imagerie pour se laisser totalement aller à une rêverie érotique.
Car une fois abordé dans cette disposition, Les Garçons Sauvages devient fantastiquement plaisant, lorsque l’on parvient à maintenir un état hypnotique dans lequel on ne fait que s’abreuver des images. Moins le film essaye d’avoir du sens, plus il est magnétique, et c’est dans ses séquences les moins narratives et les moins cartésiennes que l’on trouve des alcôves parfaitement jouissives, puisqu’elles permettent au film de s’exprimer dans toute sa beauté plastique.
 Une séquence onirique aussi folle que brève
Une séquence onirique aussi folle que brève
Car si le film a une qualité phénoménale, c’est qu’il est plastiquement beau, incroyablement beau même, à tel point que sa seule plastique justifie d’y consacrer 1h50 de son temps. La matériau argentique trouve ici un maître incroyablement brillant en la personne de son réalisateur (également cadreur), qui enchaine les plans picturaux beaux à en crever et les cadres splendides aussi facilement que s’il triait ses chaussettes.
On tient peut-être là quelque part la vraie raison d’être de ce premier film de Bertrand Mandico : c’est une pure œuvre de plasticien, qui maîtrise parfaitement son outil, arrive magistralement à convoquer ce qui se trouve aux confins de notre imaginaire et sait rendre compte des différentes ambiances à merveille mais ne se préoccupe pas de ses effets de sens et se réfugie dans des symbolismes parfois ludiques mais souvent lourdauds.
À titre d’exemple, l’idée de vouloir filmer des hommes perdus dans une nature hyper-sexuée, presque dotée d’organes génitaux, a quelque chose de follement intriguant, malheureusement à l’écran cela ne se traduit que par une série d’images répétitives dans lesquelles nos personnages sucent des arbres pour s’abreuver. Ce qui, à l’image du film, est certes original, mais n’est ni drôle, ni subversif.
On ne demandait qu’à l’aimer, on a du mal à rentrer dans cette fantasmagorie. Mais la simple existence de ce film si particulier est déjà une source de joie, et il mérite que les plus hardis et les plus rêveurs tentent leur chance, ils pourraient y trouver magnifiquement leur bonheur. Cependant, n’oubliez pas de déposer votre cerveau à l’entrée de la salle, et laissez vous porter sans trop vous poser de questions dans ce somptueux bain de plastique argentique. Sinon, ça va être difficile à vivre.
Lino Cassinat







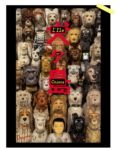
 © 2026
© 2026
Comments by Lino Cassinat