– Sofia Coppola ; 2017 –
En choisissant de réadapter le roman de Thomas Cullinan, Sofia Coppola renoue avec le cinéma historique et tente de poursuivre à cette occasion le leitmotiv proprement féminin de son oeuvre. L’ambition de remettre l’histoire originelle au goût du jour plus de 40 ans après l’adaptation de Don Siegel semble tout à fait louable, bien que nécessitant dès lors un angle nouveau afin de ne pas simplement épouser les contours de la réalisation de 1971. L’idée de voir la réalisatrice derrière la caméra est néanmoins tout à fait envoûtante, elle seule semblant à même de brosser des portraits de femmes plus éloquents qu’au sein de la réalisation précédente. L’interrogation qui subsiste toutefois est celle de l’originalité de cette nouvelle adaptation ; assiste-t-on à une simple copie de la réalisation de Don Siegel ou Sofia Coppola parvient-elle à transcender son matériau pour en faire un objet cinématographique à la fois singulier et audacieux ?
Il semble dans un premier temps difficile de juger Les Proies en occultant tout à fait l’adaptation de 1971. Si Sofia Coppola tente dès le générique d’ouverture d’imposer une esthétique particulière qui n’est pas sans rappeler celle de Marie-Antoinette, on notera très vite que la réalisation embrasse parfaitement et le scénario originel, et le cadre que proposait Don Siegel. Le 35mm permet certes de donner plus de vie à la forêt environnant le pensionnat de jeunes filles, mais ce format ne permet toutefois pas de différencier complètement cette dernière de celle où agonisait Clint Eastwood. Outre la comparaison que l’on pourrait extrapoler à l’ensemble de la réalisation, il faut avant tout souligner que le travail de Sofia Coppola n’est pas celui d’une simple copiste, mais qu’il s’agit davantage ici d’une oeuvre d’épuration, comme si la réalisatrice cherchait de ce fait à rendre l’épisode qui nous est raconté plus simple, lui conférant peut-être par là même sa singularité narrative ; en ce sens la réalisatrice de Virgin Suicides mue le roman de Cullinan en une nouvelle cinématographique certes épurée, mais pas moins complexe.
Il s’agit en effet pour Sofia Coppola de proposer un long-métrage épuré des artifices de la grande Histoire, en témoigne l’effacement, ou du moins le déplacement, des problématiques de la Guerre de Sécession qui demeuraient pourtant centrales au sein de la réalisation de 1971, comme le démontre le traitement de la question de l’esclavage dans le sud des Etats-Unis. L’oeil de Coppola se porte dès lors davantage vers le pensionnat, oubliant presque ce qu’il se passe au-delà des grilles, cette guerre devenue bruit de fond et lueur pâle entremêlée de fumée au loin, par-dessus la cime des arbres de Virginie. Ce parti-pris de proposer une réalisation davantage épurée conduit néanmoins à un certain manque de profondeur, tant en ce qui concerne les personnages que la situation globale. Là où Don Siegel offre une réalisation foisonnante, Coppola propose malheureusement une adaptation assez pauvre en termes de background ; le caporal John McBurney manque de ce fait de profondeur, tout aussi bien que Miss Martha. Rappelons tout de même que, malgré la frustration d’une telle légèreté de scénario, le récent Dunkirk de Christopher Nolan est brillamment parvenu à caractériser des personnages sans histoire aucune, choisissant de ne faire vivre au spectateur que l’intensité de l’instant présent. Ainsi Sofia Coppola semble-t-elle, elle aussi, consacrer le primat de l’action.

American Zoetrope
Les Proies parvient cependant à se parer d’une certaine singularité dans son traitement des personnages, ou plus précisément dans sa manière de les mettre en scène. Outre le traitement de la lumière bien plus appréciable que dans l’adaptation de 1971, c’est avant tout la virtuosité avec laquelle la réalisatrice capte les regards et les mouvements des jeunes femmes à l’écran qui se révèle marquante. Sofia Coppola met en scène une certaine esthétique de la préciosité qui embrasse à merveille le contexte à la fois historique et géographique qui est ici dépeint. Entre les regards passionnés d’Elle Fanning, qui se rapprochent globalement de ce que proposait l’actrice dans The Neon Demon, et les rires étouffés de cette petite communauté en présence de l’étranger Colin Farrell, Sofia Coppola saisit à merveille l’essence féminine de l’oeuvre originelle. Il faut également noter le très beau contre-pied de la part de cette dernière qui, bien que proposant une oeuvre plus graphique, en témoignent les plans sur la blessure du caporal, parvient à éviter l’écueil de l’hyper-sexualisation des personnages ; la sensualité n’est désormais plus que suggérée et la dimension charnelle présente dans l’adaptation de Don Siegel s’efface presque complètement. Cette singularité de la réalisation nous laisse dès lors entrevoir le glissement d’une caméra proprement féminine à l’ébauche d’une oeuvre féministe au service de portraits féminins convaincants, notamment du fait d’une pudeur somme toute assez touchante.
De fait, la symbolique toute entière paraît servir cette idée d’une réalisation qui graviterait autour de l’image de la femme. Là où Clint Eastwood campait un soldat vicieux et assez détestable, Colin Farrell est présenté bien plus en retrait, presque comme s’il s’agissait d’une victime innocente. Le renversement de la focalisation, du caporal aux jeunes femmes, permet dès lors l’affirmation plus marquée de la force féminine qui se dégage du pensionnat. La photographie de Philippe Le Sourd confère par ailleurs une mystique particulière au théâtre de l’action, renforçant ainsi l’idée d’une présence féminine malicieuse, si ce n’est dangereuse. On pourra ainsi s’interroger sur la symbolique du jardin, très vite affilié dans l’imaginaire collectif à la Nature (wilderness) typiquement étasunienne du 19ème siècle (citons, par exemple, Nathaniel Hawthorne et sa peinture d’une Nature intimement liée à Hester Prynne dans The Scarlet Letter) ; symbole de liberté mais aussi de piège, ce jardin aux allures de forêt luxuriante est à mettre en lien avec les femmes du pensionnat. Il n’est dès lors pas étonnant de constater l’échec de l’intégration du caporal McBurney au sein de la communauté alors qu’il vient remettre de l’ordre dans cette nature foisonnante ; d’aucun penserait par conséquent qu’il attente ici à la liberté des femmes qui l’ont sauvé. Par ailleurs, la présence de la forêt au sein de ce qui devrait être un jardin nous laisse également entrevoir l’idée d’une pénétration et du monde extérieur, et de l’élément masculin (ici symbolisé par la guerre qui fait rage dans et au-delà des bois) dans un monde à la fois clôt et féminin.

American Zoetrope
Enfin, la traduction étrange et inchangée du titre semble elle aussi à interroger. Si l’on s’attache effectivement à la traduction française, il est possible de constater au sein de la réalisation de Sofia Coppola l’échec du projet originel ; là où Don Siegel faisait de Clint Eastwood un véritable prédateur, la réalisatrice fait de lui un amant passif qui ne deviendra lui-même prédateur que dans le dernier quart du long-métrage. De fait la réalisation évoque bien moins le danger, l’aspiration au basculement que la première adaptation. Concernant le titre original, The Beguiled, il bénéficie d’une ambivalence bienvenue au sein de cette parenthèse de la Guerre de Sécession, puisqu’à même de désigner aussi bien le caporal que les jeunes femmes du pensionnat ; notons tout de même, encore une fois, que la séduction et la sensualité ont un poids moindre dans la réalisation de Coppola.
En définitive, Les Proies de Sofia Coppola demeure une belle adaptation du roman de Thomas Cullinan, malgré la frustration d’une histoire épurée. L’aspect proprement symbolique de la réalisation permet de lui conférer une identité singulière, malgré une mise en scène assez convenue et proche de celle de Don Siegel. Sans être le morceau de bravoure de la filmographie de Sophia Coppola, Les Proies se révèle être un film mature et envoûtant, filant à merveille les thématiques que la réalisatrice déploie dans l’ensemble de son oeuvre.
Vincent Bornert


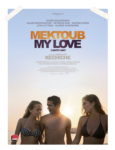




 © 2026
© 2026
Comments by Vincent Bornert