Des hommes fatigués, seuls, aux mains très abîmées, au regard parfois aveugle. Une main qui tremble sur la toile cirée d’une vieille cuisine.
C’est l’un de mes souvenirs de La Vie Moderne, de Raymond Depardon. Documentaire poignant qui m’aura laissé pour longtemps le souvenir d’avoir touché, à de nombreuses reprises, quelque chose de l’ordre de la vérité, hors de tout voyeurisme, de tout sensationnalisme, et de tout bavardage inutile.
La force de ce genre, au regard d’autres productions contemporaines à vocation politique, est source d’interrogations sur la nature même du documentaire, sur sa place dans l’art contemporain. Et si le film documentaire était l’art le plus éthiquement politique du XXIème siècle ?
Écueils de l’art contemporain (ou : ce que le documentaire n’est pas)
Dominique Baqué développe cette thèse dans son ouvrage Pour un nouvel art politique, sous-titré « De l’art contemporain au documentaire »(1). Pour L’autrice, le film documentaire, à la croisée de plusieurs régimes d’expression, parviendrait à éviter deux écueils majeurs : d’une part, la futilité de ce que Baqué nomme « l’art relationnel » contemporain, et d’autre part, le voyeurisme du reportage journalistique.
Dans la première partie de l’ouvrage, extrêmement documentée et forte d’exemples parfaitement choisis, l’autrice dresse un état des lieux de la production artistique depuis la fin des années 1980, à l’aune du rapport qu’elle entretient avec la question politique. Elle classe ces productions dans trois grandes familles : l’art « en-deçà du politique », l’art « néo-avant-gardiste », et l’art « relationnel ».
Entertainment et repli sur soi
Une partie de l’art contemporain semble en effet laisser de côté toute préoccupation éthique pour proposer une esthétique du fun, de l’entertainment, tels les fameux Murakami et Koons — qui, ça n’est pas un hasard, font partie des plus côtés sur le marché de l’art… L’artiste, séduit par les sirènes du capitalisme, se rêve alors en chef d’entreprise. Plus ambiguës sont les œuvres qui s’écartent du politique pour lui préférer la voie de l’intime : face au chaos du monde en effet, le repli sur soi n’est-il pas une sage attitude ? Mais, comme le montre Baqué, ces œuvres achoppent souvent sur les mêmes écueils. Là où une Nan Goldin est parvenue au moyen de la photographie à « faire [de l’intime] un monde, et de son œuvre un témoignage éminemment politique sur le « hors-champ » de la société américaine — gays, drag queens, toxicomanes, femmes d’errance et hommes de violence »(2), la plupart de œuvres de l’intime s’avèrent terriblement creuses. Et Baqué de s’amuser en sous-texte de la persistance de certains critiques à vouloir assigner un sens politique et éthique à la production de certains artistes. Florilège : « aux critiques, fort nombreux, qui s’évertuèrent à infléchir son travail du côté du féminisme, voire d’une revendication homosexuelle, ou qui attendirent l’articulation d’un concept, la jeune artiste répondait inlassablement que non, elle n’était ni féministe, ni gay, ni engagée dans quelque combat que ce soit, préférant à l’évidence exprimer avec une sincérité aussi désarmante que sotte ses désirs du moment et jouant du même coup la frivolité légère contre la pesanteur du concept : « A Barcelone, l’été dernier, j’ai eu envie de me faire mettre des dreadlocks, je les ai portées pendant quatre jours, c’était bizarre. »(3)
Dérives de l’art caritatif, futilité de l’art relationnel
Baqué s’intéresse ensuite à ceux qu’elle nomme les « néo-avant-gardes ». Ces artistes, à l’inverse des précédents, tentent résolument de s’inscrire dans le champ politique, en menant à travers leur production une réflexion éthique et engagée. Or, avec les exemples de Lucy Orta et Krzysztof Wodiczko, l’on s’aperçoit que si ces artistes font preuve d’une véritable « générosité éthique », leur tentative d’infléchir l’art du côté de l’action militante n’aboutit que sur une frustration : l’art, par sa nature même, ne parvient pas à refaçonner le réel. C’est ce que Baqué appelle la dérive d’un « art caritatif ». Vêtements pour démunis qui s’inscrivent dans le champ de la mode chez Orta, dispositif nomade aux accents futuristes chez Wodiczko, promettant de faciliter le contact entre étrangers… Autant d’initiatives partant d’un bel engagement mais qui ont « quelque chose de gênant » : l’esthétisation de la « misère du monde », sous l’égide du design.
Les années 1990 marquent l’avènement d’une volonté nouvelle d’assigner à l’art la mission de faire lien. En réponse aux fractures sociales, l’art permettrait de renouer quelque chose, de colmater les fissures — et de boucher les trous. Vacuité de cette forme d’art, nous met immédiatement en garde l’autrice. On peut s’étonner en effet du peu de choses dont se satisfont ces artistes : l’un propose de partager un repas, l’autre de danser dans une galerie au son d’un magnétophone… Certains critiques diront même d’un Felix Gonzalez-Torres, qui propose aux spectateurs de grignoter des friandises, qu’il leur permet de faire « l’expérience radicale […] du libre-arbitre » (4) !
Et le cinéma, dans tout ça ?
Le tableau, on l’aura compris, est sombre. En réponse à ces apories de l’art contemporain — qui sont évidemment développées dans l’ouvrage de façon bien moins schématique qu’ici — Dominique Bacqué se penche sur la question du documentaire.
Elle s’attache d’abord à distinguer le documentaire du reportage. Là où le reportage se contente d’une vision parcellaire, le documentaire ouvre une voie nouvelle, caractérisé par la volonté tenace d’approcher la vérité. En effet, après l’âge d’or des reportages photographiques de la fameuse agence Magnum, la révolution roumaine et la guerre du Golfe donneront lieu à une véritable crise des images : d’une part, le grand public découvre que les charniers de Timisoara, rendus célèbres par les journalistes durant la chute de Ceausescu, et qui avaient été comparés aux camps nazis, sont truqués. D’autre part, le gouvernement américain organise une scénographie visuelle clinique de la guerre du Golfe : tout semble propre, net, hygiénique : « des écrans, des satellites, des avions dits « furtifs » et des cibles à détruire : du peuple irakien il n’était pas question. […] Conséquence : devant une telle asepsie, la nécessité même de témoigner devenait caduque »(5).
Le documentaire : un art éthiquement politique
Dès lors, il devient urgent de trouver une forme esthétique éthique, qui permette de remettre la vérité au cœur du témoignage. C’est la naissance d’une esthétique du plan large, qui permet de donner à voir le hors-champ : ce que Depardon appellera « une photographie des temps faibles ». Fuir la grandiloquence du reportage pour approcher, le plus possible, la discrétion de la vérité. Cela passe également par la souplesse de l’objet documentaire, qui doit être capable d’ « accueillir le réel dans son imprévisibilité même et son effet de résistance »(6) ; par la durée aussi, car le documentaire participe d’un véritable processus de recherche. Cela passe enfin par l’importance de la parole : là où l’art s’est trop souvent enfermé dans un mutisme arrogant ou s’est laissé séduire par le « bruit relationnel », le documentaire reconstruit la parole comme témoignage transmissible »(7).
Le documentaire émerge ainsi chez Dominique Baqué comme la forme la plus probante d’art politique, parce que son esthétique même laisse toute la place nécessaire à la parole, et donc, à l’Autre. Loin de la mascarade journalistique et du vide d’une certaine forme d’art contemporain, il va, simplement, et nous rappelle l’importance du temps long : si le documentaire peut se targuer de dire quelque chose de l’état du monde, c’est parce qu’il en prend le temps.
Lucie Mollier
Bonus : Quelques titres de documentaires cités dans l’ouvrage :
> Reporters, Raymond Depardon (1981)
une critique acerbe de l’ancien métier du réalisateur.
> Primary, Robert Drew (1959)
documentaire sur les primaires américaines opposant Kennedy et Humphrey
> Comme un coup de tonnerre, Casa, Meunier et Roche
retour sur l’échec de Jospin à la présidentielle de 2002
> Délits flagrants, Raymond Depardon (1994)
Au cœur du Palais de justice de Paris, les interrogatoires de prévenus pour petite délinquance
> Bondy Nord, c’est pas la peine qu’on pleure, Claudine Bories (1993)
sur la précarité dans la banlieue Nord de Paris
> La Voix de son maître, Nicolas Philibert (1978)
des patrons de grands groupes s’étendent sur leur vision du monde
> Paroles de Bibs, Jocelyne Lemaire-Darnaud (2001)
donner la parole aux employés des usines du groupe Michelin
> Bophana, une tragédie cambodgienne, Rithy Panh (1996)
la figure du bourreau dans le génocide des Khmers Rouges
NB : écouter à ce sujet le podcast de l’interview du réalisateur par Laure Adler dans l’émission « L’heure bleue », sur France Inter.
> L’Ennemi intime, Patrick Rotman (2002)
sur la torture perpétrée par des Français sur les Algériens durant la guerre d’Algérie.
> De l’autre côté, Chantal Ackerman (2002)
sur la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique
> Massoud l’Afghan, Christophe de Ponfilly (1998)
sur l’itinéraire politique, guerrier et spirituel d’Ahmad Shah Massoud
NOTES
- BACQUÉ, Dominique, Pour un nouvel art politique, Paris, Flammarion, coll. « Champs art », 2009.
- Op. cit., p. 57.
- Op. cit., p. 47.
- Op. cit., p. 155.
- Op. cit., p. 179.
- Op. cit., p. 210.
- Op. cit., p. 213.

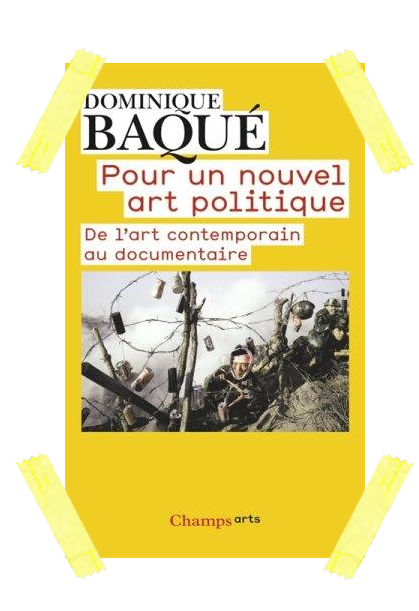



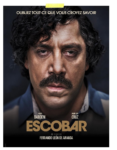

 © 2024
© 2024
Comments by Camille Muller
Les filles d’avril de Michel Franco : combat de mères
Très bon commentaire que je (Camille Muller) ne peut ...
« Un bon gros Totoro et au dodo »
Merci à vous pour votre soutien ;)
Les filles d’avril de Michel Franco : combat de mères
Merci beaucoup pour ce commentaire, ça fait chaud au coeur ...
Django d’Étienne Comar: idole parmi les oubliés
Merci pour ce beau commentaire Rémy, on ne peut ...
Oscars 2017 : Retour sur La La Land de Damien Chazelle
Merci Jeanne, petite coquille sur ce coup :)