À la veille du premier tour des élections présidentielles françaises, le deuxième film de Pierre Schoeller (après Versailles, en 2008) tombe à point nommé. Le spectateur découvre une vision haletante des arcanes du pouvoir en France, loin des emplois fictifs et des costards hors de prix, mais qui n’en demeure pas moins extrêmement juste, lucide, et désenchantée. Représenter, exercer, faire marcher l’État, qu’est-ce que ça veut dire ?
C’est en s’immisçant avec une grande finesse dans l’existence du ministre des transports, Bertrand Saint-Jean, joué par l’excellent Olivier Gourmet, que Schoeller tente de répondre à cette question. Homme d’Etat, Saint-Jean l’est pleinement. Les traits tirés, il part travailler au milieu de la nuit à l’annonce d’un accident de car, court, téléphone, argumente, s’endort dans son taxi, oublie le départ de sa fille pour le Caire, se rappelle vaguement de l’anniversaire de sa femme, donne des ordres, chute, rebondit, se révolte, et téléphone encore. Etre ministre des transports accapare ses jours, ses nuits, et même ses rêves, à en croire le cauchemar d’une femme nue avalée par un crocodile, scène d’ouverture et vision prophétique de cet exercice dévorant qu’est celui de l’Etat. Saint-Jean et son équipe se retrouvent pourtant bientôt isolés au sein du gouvernement autour de la question de la privatisation des gares. Saint-Jean, qui porte lui-même le nom de la gare de Bordeaux, s’y oppose fermement. Le ministre fait donc face à un dilemme : garder son cap en défendant son idéologie et ses valeurs, ce qui lui couterait sa tête, ou rentrer dans le rang et « écrire son histoire » en devenant le ministre de la privatisation des gares.
Un Etat pervers polymorphe
« L’Etat c’est devenu une misère, une vieille godasse qui prend l’eau de partout. »
Schoeller nous livre une vision sans fard et quelque peu désillusionnée de cette entité imposante qu’est l’Etat en France. Placée au premier plan de ce film, détentrice d’une aura contestée car désuète aux yeux des plus libéraux, cette force publique affronte les médias carnassiers, les enjeux de la crise économique et les rivages miroitants du privé, représenté ici par Vinci qui puise ses dirigeants jusque dans les hautes sphères de l’État. Sa couverture sociale, grande fierté nationale, est mise à mal avec l’image de ces chômeurs blafards recrutés à la va vite pour satisfaire les quotas, et photographiés, hagards, sur le perron de l’Élysée.
On comprend alors rapidement que le ministre dispose de bien peu de marges de manœuvre. Bien plus qu’il n’exerce l’État, c’est l’État qui, derrière la figure du « père », exerce sur lui un pouvoir, et lui impose une ligne de conduite ferme à tenir. C’est pourquoi le personnage de Bertrand Saint-Jean ne nous est pas antipathique. Derrière un physique banal et humain, le ministre patauge, se démène, jongle, et suit un délicat parcours d’équilibriste tout au long du film.

Diaphana Distribution
Heureusement, l’impeccable Michel Blanc (César du meilleur acteur dans un second rôle) est là pour nous réconcilier avec les hautes sphères. Implacable directeur de cabinet, proche de Bertrand, il incarne Gilles, homme intègre et de convictions qui se délecte en peignoir des discours de Malraux, et s’impose comme le représentant stable et rassurant de la République comme l’ont en tête les plus idéalistes. Désintéressé de la folie médiatique, il préfère reprendre son ancienne fonction de préfet plutôt que d’accompagner son ministre et ami dans cette privatisation des gares à l’encontre de son idéologie.
Le rythme effréné du pouvoir
« – On compte 13 morts.
– 13… Bouches-du-Rhône. »
Ce film nous entraine à un rythme effréné dans une succession de séquences qui se juxtaposent à toute vitesse. On passe d’un lit conjugal à une route enneigée des Ardennes, d’une scène d’enterrement à un shooting photo, d’une crise téléphonique sur une aire d’autoroute au son ouaté des cabinets ministériels. Les sujets les plus graves sont traités efficacement, frontalement, rapidement. Il s’y mêle toujours un apparent détachement affectif (13 morts, 13 comme les Bouches du Rhônes) et de triviaux soucis de comm’. Saint-Jean se trouve donc contraint à changer de cravate en pleine nuit sous une tente du SAMU, avant son intervention télévisée, la mort d’adolescents devenant ainsi un moyen de remonter dans les sondages, un véritable objet médiatique. C’est à travers ces réalités paradoxales qui se cognent, se juxtaposent, s’entremêlent, que Schoeller est au plus près de la réalité qu’il entend filmer.
Schoeller joue des images et des sons (on salue ici une bande originale très travaillée) pour embarquer, voire épuiser le spectateur, qui se retrouve malmené par l’afflux de dialogues échangés à la volée, de musiques angoissantes et de gros plans. Mais il sait également ménager des pauses dans le récit, qui apaisent le public et apportent une densité supplémentaire aux personnages. On pense ici à la belle scène du repas partagé dans la caravane entre Saint-Jean, son chauffeur et sa femme.
Sorties de route
« – Je crois que j’ai fait une fausse route.
– C’est con pour un ministre des transports ! »
Tout au long du film la métaphore de la route est filée, à l’image de la fonction ministérielle choisie. La route matérielle d’abord, celle qu’on emprunte, celle qu’on construit, celle qu’on ne peut quitter sans risquer l’accident. Mais aussi les fausses routes, au sens figuré, physiologiques et psychologiques. En effet, le film livre parfois une image quasi organique de l’Etat à travers son ministre qui sort en trombe de la voiture pour vomir, avale de travers, tousse, crache… Mais c’est aussi la route spirituelle et les méandres de la conviction et de l’ambition qui sont abordés ici. Jusqu’où peut-on garder le cap tout en gardant le pouvoir ? Comment réussir à filer droit, à éviter les embûches, les chemins de traverse ? Comment tracer sa voie, construire son histoire ?
Finalement, après un événement choquant et surprenant, le film opère un retournement de situation et insiste encore davantage sur la désillusion de Schoeller à l’égard du pouvoir en France. Le dernier tiers du film s’attarde avec théâtralité sur la dimension tragique, fatale, de l’exercice de l’Etat, véritable sirène qui envoûte les indécis et écarte les plus fidèles.
Avant de faire son devoir citoyen et de se rendre aux urnes il fait bon regarder l’Exercice de l’Etat. Ce film fait l’effet d’un miroir grossissant des coulisses du pouvoir que s’arrachent à l’heure actuelle quatre candidats principaux. Il nous aide à comprendre les travers d’une telle puissance et ce qui se joue au plus profond de L’État, et nous permet de réaliser combien il est important de choisir ceux qui l’exercent.
Louise Pedespan-Joly.





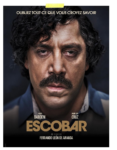

 © 2024
© 2024
Comments by Camille Muller
Les filles d’avril de Michel Franco : combat de mères
Très bon commentaire que je (Camille Muller) ne peut ...
« Un bon gros Totoro et au dodo »
Merci à vous pour votre soutien ;)
Les filles d’avril de Michel Franco : combat de mères
Merci beaucoup pour ce commentaire, ça fait chaud au coeur ...
Django d’Étienne Comar: idole parmi les oubliés
Merci pour ce beau commentaire Rémy, on ne peut ...
Oscars 2017 : Retour sur La La Land de Damien Chazelle
Merci Jeanne, petite coquille sur ce coup :)