-José Padilha ; 2018-
En ce dimanche 27 juin 1976, le vol de l’Airbus A300 Tel-Aviv-Paris voit son cours perturbé. Alors qu’il survole la Grèce, un groupe de quatre terroristes a pris en otage l’ensemble de son équipage, se revendiquant du Front de Libération de la Palestine ou « humanitaires », comme le défend Wilfried Böse (Daniel Brühl) devant des passagers terrifiés. Une fois la cabine sous contrôle, l’Allemand fera changer de cap au commandant, direction l’Ouganda. Bien décidés à libérer leurs camarades révolutionnaires détenus en Allemagne et à faire changer le sort des Palestiniens, Wilfried et ses coéquipiers conduisent leurs otages dans un terminal désaffectés en attendant des négociations avec Israël.
On connaît la capacité de José Padilha à construire des œuvres d’époque crédibles, comme le réalisateur nous l’a prouvé avec sa série Narcos consacré au mythique Pablo Escobar. Ici encore, le Brésilien nous plonge dans un fait historique capital et sous tension en s’intéressant à la prise d’otage du vol Airfrance à destination de Paris. Un avion dans lequel se trouvaient un nombre important de passagers israéliens, précieuse « monnaie » d’échange pour des terroristes en quête de changements pour le peuple palestinien. Désireux de faire évoluer le conflit vers une situation plus acceptable pour ceux qu’ils considèrent comme des victimes absolues, deux Allemands appartenant à la Bande à Badeer : Wilfried et Brigitte se sont investis corps et âmes dans cette mission. Appartenant à l’élite intellectuelle de l’Allemagne, ces protagonistes nous sont présentés à coups de flash-backs dispensables parce que clichés, qui ont toutefois le mérite d’expliciter les motivations et la détermination de ces coéquipiers. Prêts à mourir pour leurs idéaux, ces terroristes représentent des adversaires dangereux et à ne pas sous-estimer pour le gouvernement israélien, jusqu’alors réticent à toute forme de négociation avec l’oppresseur. Une politique de non-intervention mise à mal par l’implication du dangereux et instable maréchal-président ougandais Idi Amin Dada, prêt à tout pour montrer son allégeance au camp communiste contre Israël. Un être superstitieux et totalement hors de contrôle campé par le convaincant Nonso Anozie qui réussit brillamment à ne pas tomber dans une peinture caricaturale de son personnage et nous livre un portrait à la fois risible et glaçant du dictateur. À l’instar de son travail documentaire dans Narcos, José Padilha appuie cette quête de réalisme avec l’utilisation d’images d’archive télévisuelles qui ancrent son œuvre dans l’histoire et lui confère davantage de légitimité sans pour autant l’alourdir.

.UGC distribution
C’est une vasque fresque que compose ici le réalisateur, s’entourant d’une multitude de sphères et de personnages pour construire son récit. Il retourne à ses amours connues que sont les jeux de la politique, du pouvoir et de la violence en dépeignant un État israélien rongé par des guerres intestines. Yitzhak Rabin fait ainsi face à un Shimon Peres plus détestable que jamais, chapotant d’un œil fourbe l’opération militaire depuis son siège de Ministre de la Défense national. Partisan de la protection aveugle du peuple israélien, c’est avec précipitation que cet homme souhaite agir, son enthousiasme peu réaliste à montrer la toute puissance du pays et de son armée étant à de maintes reprises freinés par son Premier ministre Rabin. Ce dernier, incarné par un Lior Ashkenazi à la justesse indéniable et magnétique, milite encore et toujours pour un apaisement des tensions avec l’extérieur, bien conscient de l’épée de Damoclès qui pèse sur l’avenir de sa nation. Un pays fermé, mis à mal par une grande partie du monde pour sa volonté expansionniste et conquérante. Une nation encore douloureusement marquée par la Shoah, ce que rappelle Padilha tout en marquant bien l’empreinte au fer rouge que ces horreurs ont laissées sur les citoyens allemands. Pour cause, Böse se retrouve à de nombreuses reprises confronté aux crimes de ses aînés, mis devant le concept absurde et violent d’Israëliens – et Juifs – pris en otage par des terroristes allemands. Souvent confronté par le mécanicien Jacques Lemoine (quel bonheur de revoir Denis Ménochet), le révolutionnaire ne pourra faire abstraction de cet étrange paradoxe : en quête de liberté pour le peuple palestinien, il devient malgré lui le bourreau du peuple juif, comme nombres de ses concitoyens avant lui. Malgré des flash-backs ratés, Böse et sa partenaire restent deux personnages très intéressants que l’on apprend à connaître dans le feu de l’action. Daniel Brühl et Rosamund Pike offrent tout deux une composition crédible et l’on regrette que la diversité et l’exhaustivité de ce tableau historique ne leur laisse davantage la parole. En dépit de discours bien rôdés et d’idéaux défendus de longue date, ces terroristes n’en demeure pas moins de être faillibles dont les convictions ne font que s’effriter au fil de la prise d’otage. Ainsi, Otages à Entebbe marque les contradictions inhérentes à leur entreprise et donne davantage d’humanité à ces révolutionnaires habités par l’envie de rétablir une justice – unilatérale – qu’ils jugent baffouée.

.UGC distribution
Traitant avec exhaustivité mais neutralité des différents camps qu’il met en confrontation, José Padilha nous livre un film riche en intrigues et en enjeux tant personnels que collectifs. En mettant en parallèles trois récits principaux que sont la prise d’otage, l’opération de sauvetage tant politique que militaire des prisonniers et un couple israélien, le metteur en scène nous confronte aux multiples impacts du conflit israélo-palestinien. En s’attachant au destin amoureux d’une danseuse et d’un soldat, le réalisateur de Narcos montre encore une fois le courage de ceux qui restent, impuissants face à l’engagement de l’être aimé pour la défense nationale. Cette histoire d’amour, quoique traitée un peu en superficie (mais en un sens, heureusement), permet également de faire un parallèle intéressant entre danse et armée. Que ce soit lors des entraînements ou de la représentation finale tant militaire qu’artistique, danse et combat se répondent et forment un ensemble cohérent à l’importance narrative notoire. Attendu au tournant sur la séquence finale de l’œuvre traitant de l’intervention des troupes israéliennes en Ouganda, José Padilha répond brillamment aux attentes engagées. Introduisant cette séquence avec les multiples portraits de ses personnages avant l’attaque, le metteur en scène fait progressivement monter la tension en posant ses différentes intrigues à coups de plan larges savamment construits. Impossible de ne pas penser alors à Wagner Moura contemplant les collines colombiennes, Pablo Escobar prenant un instant de répit devant ses poursuivants déterminés à mettre fin à son règne.

.UGC distribution
Ici aussi, au calme succède la tempête. Beauté esthétique et sens du rythme se combinent tandis que le montage, ponctué par une bande-son endiablée, fait se suivre les enjeux jusqu’au point paroxystique. Sans bavure ni mélo, le metteur en scène livre une séquence d’assaut très réussie, bien qu’alourdie par des ralentis dispensables. En parallèle, une chorégraphie à la fois magnifique et violente, pensée par le maître israélien Ohad Naharin questionne et pose différents enjeux déjà sous-tendus dans l’œuvre. Une femme s’effondre, encore et encore, parmi une assemblée véhémente et féroce, combattive. Serait-ce une tentative de paix réduite à néant par des acharnements belliqueux, à l’image de Rabin et Peres en opposition au sommet du pouvoir ? Ou bien Israël face au reste du monde, condamné dans sa volonté impérialiste pourtant jugée légitime par des années de persécution ? Ou encore, Histoire oblige, les souffrances du peuple juif face à ses multiples détracteurs à travers le temps ? Nul ne nous donnera de réponse, et le film se clôt ici aussi sans mélo, rétablissant les faits historique et rappelant la perpétuation du conflit malgré le combat de Rabin et l’engagement de Peres après lui. L’œuvre est ainsi témoin d’une sombre et tragique histoire d’immobilisme, à l’image de cette femme courant perpétuellement dans le vide en générique de fin. Ou des gestes répétés à l’identique d’un danseur quasi-statique. Un cercle sans fin de violence et de représailles qui s’alimente chaque jour, sous nos yeux résignés.
Camille Muller




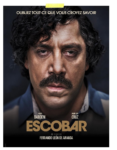


 © 2025
© 2025
Comments by Camille Muller
Les filles d’avril de Michel Franco : combat de mères
Très bon commentaire que je (Camille Muller) ne peut ...
« Un bon gros Totoro et au dodo »
Merci à vous pour votre soutien ;)
Les filles d’avril de Michel Franco : combat de mères
Merci beaucoup pour ce commentaire, ça fait chaud au coeur ...
Django d’Étienne Comar: idole parmi les oubliés
Merci pour ce beau commentaire Rémy, on ne peut ...
Oscars 2017 : Retour sur La La Land de Damien Chazelle
Merci Jeanne, petite coquille sur ce coup :)