Invités dans le cadre du cycle « Le Monde est Stone » organisé par le Forum des Images en l’honneur et avec la collaboration du réalisateur Oliver Stone, les rédacteurs cinéma de Scotchés reviennent sur certains des plus grands classiques du cinéma américain.
Aujourd’hui, retour sur Le Grand chantage de Alexander Mackendrick, œuvre traitant du journalisme et de ses penchants les plus sordides…
Réalisé en 1957, Le Grand chantage peut se targuer de recouper des icônes du cinéma américain telles que Burt Lancaster et Tony Curtis et nous plonge dans une New York faite de noirceur et de perversité. Tournée en noir et blanc, cette œuvre aborde frontalement des problématiques telles que la corruption et le traitement des femmes en mettant en scène des personnages aussi détestables que JJ Hunsecker – incarné par Burt Lancaster – et Sidney Falco, interprété par Tony Curtis. Pour toile de fond, Raoul Walsh met en scène la relation complexe liant Sidney et JJ, chroniqueur célèbre de la métropole, homme d’influence usant de ses relations pour accomplir ses desseins personnels. Bien décidé à garder sa sœur Susie à ses côtés, pour laquelle il nourrit des sentiments quasi incestueux, le journaliste met tout en œuvre pour la séparer de son amant et promis Dallas, guitariste dans une troupe de jazz en plein essor. Pour accomplir cette sombre volonté, JJ demande l’aide de Sidney, agent de presse avec lequel il entretient un lien trouble mêlant ancienne amitié et mépris non dissimulé. Ce « chien », comme le désignent nombres de protagonistes du récit, représente à lui seul toutes les dérives de la société américaine dénoncées par Mackendrick dans son long-métrage.
En construisant son œuvre sur une intrigue complexe basée sur une série de manipulations orchestrées par JJ et Sidney dans le but de ruiner l’idylle entretenue par Dallas et Susie, le metteur en scène nous livre un portrait multiple et riche d’une société corrompue et rongée par le vice. Du journaliste détestable qui oblige une vendeuse de cigarettes à coucher avec lui, au flic ripou et violent en passant par le rédacteur en chef pervers d’un grand journal new-yorkais ; Alexander Mackendrick n’épargne aucun de ses personnages, hormis Dallas, son agent et quelques-unes des figures féminines qu’il intègre dans son récit. Au sommet de cette pyramide du vice siège incontestablement Sidney, homme sans scrupules motivé uniquement par l’appât du gain et de la célébrité. Ce personnage ignoble, combinant à lui seul lâcheté, corruption, sexisme nauséabond et haine constante de l’Autre ; nous invite avec lui dans la vie mouvementée et poisseuse de la nuit urbaine. Bien moins influent que son commanditaire JJ qui semble tenir à lui seul tous les rênes de la ville – qu’il s’agisse de ses contacts dans les mondes politique, policier et culturel, Sidney vogue allègrement dans cet univers fait de manipulations et de pots de vin. À travers lui, le spectateur découvre avec dégoût et stupéfaction toutes les malversations sous-tendant les pouvoirs les plus influents de la métropole, du sénateur en devenir aux carrières artistiques à ériger au sommet, ou à détruire.

Flash Pictures
Dénonçant allègrement le monde pourri qu’il dépeint, Le Grand chantage frappe également en raison du traitement réservé aux femmes dans cette société dominée exclusivement par la gent masculine. Dans un premier temps, la relation entre JJ et Susie semble relever d’un désir de protection d’un frère envers une petite sœur considérée comme fragile et innocente, vision patriarcale déjà largement contestable que l’on aurait pu mettre – à la limite – sur le compte d’un amour trop « imposant » et condamnable. Cet attachement de JJ à sa sœur se révèle toutefois encore plus pernicieux, sombrant résolument dans une relation incestueuse faite d’intimidation et de perversité, le grand frère se comportant comme un véritable pervers narcissique pour garder Susie sous son joug. Une attitude qui s’ajoute aux nombreux défauts de ce personnage paranoïaque et sans vergogne et qui vient finaliser le portrait à charge qu’en livre Alexander Mackendrick. Ce comportement détestable envers une femme infantilisée et emprisonnée aurait pu suffire à décrire un monde machiste et patriarcal, mais le metteur en scène ne s’arrête pas là. Pour cause, le personnage de Sidney bat tous les records en termes de traitement de la femme, lui qui va jusqu’à prostituer une ancienne amante pour obtenir une chronique dans un journal. Rappelant à Rita qu’elle doit subvenir aux besoins de son fils étudiant en école militaire et que le rédacteur à qui elle donnera son corps pourra l’aider à reconquérir son emploi, Sidney place ici cette femme acculée devant un choix cornélien. Condamnée pour un crime dont la responsabilité ne lui est pas imputable, la protagoniste devra encore une fois subir les désirs malsains des hommes qui l’entourent pour espérer s’en sortir.
Enfin, le monologue de Sidney devant la tentative de suicide de Susie, poussée à bout par les stratagèmes diaboliques de son frère, relèvent du summum du sexisme et enterrent définitivement ce personnage détestable aux yeux du public. Rappelant à la jeune femme que « s’allonger sur un lit » en compagnie d’un homme représente son salut le plus efficace face à la dépression, sachant que les femmes « pensent avec leurs hanches avec de penser avec leur cerveau », ce personnage se livre à un discours totalement dégueulasse sur la condition féminine. La chute subite de ce anti-héros, dans un dénouement inattendu et habile du scénario, ne peut qu’assouvir cruellement la satisfaction du spectateur. Cette fin cathartique, condamnant les pires bassesses et redonnant à la victime son indépendance, sauve l’œuvre d’un pessimisme écrasant et rétablit la figure de la femme qui affirme enfin son identité et ses désirs – uniquement amoureux, certes – et se libère du joug de violence qui pesait jusqu’alors sur elle.
Camille Muller





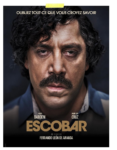

 © 2025
© 2025
Comments by Camille Muller
Les filles d’avril de Michel Franco : combat de mères
Très bon commentaire que je (Camille Muller) ne peut ...
« Un bon gros Totoro et au dodo »
Merci à vous pour votre soutien ;)
Les filles d’avril de Michel Franco : combat de mères
Merci beaucoup pour ce commentaire, ça fait chaud au coeur ...
Django d’Étienne Comar: idole parmi les oubliés
Merci pour ce beau commentaire Rémy, on ne peut ...
Oscars 2017 : Retour sur La La Land de Damien Chazelle
Merci Jeanne, petite coquille sur ce coup :)